
Alimentation et troubles mentaux
11 février 2025
Les Dangers de l’IA en Lien avec les Suicides de Jeunes
26 octobre 2025Incestueux, incestuel : la boite de Pandore.

Comprendre pour réparer.
L’inceste et le climat incestuel sont parmi les blessures les plus profondes qu’un être humain puisse porter. Ils atteignent le cœur de l’enfance, là où se construisent l’estime de soi, la confiance, le sentiment d’appartenance. Pour comprendre ces réalités douloureuses, il est nécessaire de mettre des mots précis, afin de ne pas laisser ces violences dans le silence.
Définir l’inceste et le climat incestuel.
L’inceste désigne le passage à l’acte sexuel imposé à un enfant par un membre de sa famille ou par une personne occupant une position de parenté symbolique (beau-père, belle-mère, parrain, etc.). Il nie les interdits fondamentaux qui protègent l’enfant et le place dans une confusion destructrice.
Le climat incestuel, en revanche, n’implique pas forcément de passage à l’acte sexuel. Il s’agit d’une ambiance familiale sexualisée, où les frontières entre l’adulte et l’enfant sont floues. L’enfant est perçu comme une prolongation du parent, utilisé pour combler un vide, satisfaire des besoins, se valoriser. Cela peut passer par des gestes intrusifs (embrasser sur la bouche, partager des bains avec un adolescent), des confidences sexuelles inappropriées, ou encore par la responsabilisation de l’enfant, sommé de rendre le parent heureux.
L’objectivation de l’enfant.
Dans ces contextes, l’enfant n’est plus reconnu comme un être à part entière, mais réduit à un objet de plaisir, de soutien ou de valorisation. Ce mécanisme rejoint un phénomène plus large : dans nos sociétés modernes, les êtres humains deviennent de plus en plus interchangeables, remplaçables par des objets. L’autre cesse d’être un sujet, porteur de dignité et de droits, pour devenir un instrument au service du désir ou du confort d’autrui.
Cette logique d’instrumentalisation de l’enfant est la racine même de la corruption systémique qui traverse nos sociétés : quand les familles elles-mêmes, censées être le lieu de protection, utilisent les enfants comme des objets, c’est tout l’édifice social qui se fragilise.
Les symptômes physiques et psychiques qui doivent alerter sont :
- Physiquement, les victimes peuvent souffrir de constipation chronique, hémorroïdes, de cystites répétées, de mycoses zone du sexe, d’Herpès anal, de cancers localisés (bouche, gorge, anus), d’un abandon du soin de la bouche (caries, négligence dentaire) car dégouté de ce qu’on a fait faire à leur propre bouche, endométriose chronique, fibromyalgie (car au lieu de « fuir ou se battre, on se « fige »).
- Psychiquement, les symptômes sont variés : bipolarité, maniaco-dépression, comportements suicidaires, dépression profonde, troubles de la sexualité (nymphomanie ou rejet total), comportements à risque, scarifications, piercings compulsifs, anorexie ou boulimie, addictions, compulsion à répéter le trauma. Souvent, la victime demeure prisonnière de l’impossibilité à faire le deuil de son père ou de sa mère abuseur.
Un enfant incesté, dit-on, est comme brûlé au troisième degré : il n’a plus de « peau émotionnelle ». Le thérapeute doit toujours garder cette réalité à l’esprit, et s’approcher de la souffrance avec une infinie précaution.

Les neuf fantasmes autour de l’inceste.
Nombre de mythes persistent et minimisent la gravité des abus :
- Les enfants pourraient encourager l’adulte à abuser.
- L’enfant est capable de dire non ou d’alerter sa mère.
- Une mère sait forcément si son enfant est abusé.
- Les pervers n’existent pas dans les familles « normales ».
- Les violences sont rares et commises uniquement par des malades mentaux.
- Les enfants accusateurs mentiraient pour attirer l’attention.
- Les révélations des enfants seraient manipulées par un adulte vengeur.
- Les souvenirs d’abus remontés à l’âge adulte seraient fabriqués par des psychologues.
- Les pères auraient peur de « devenir comme leur propre père ».
Ces idées fausses nourrissent le silence, la honte et la culpabilité des victimes, les isolant encore davantage.
Les différents types d’inceste.
- L’inceste maternel, souvent le plus tabou, où le corps de l’enfant et celui de la mère se confondent.
- L’inceste paternel, qui transgresse l’interdit transgénérationnel.
- L’inceste fraternel ou sororal, marqué par une dynamique de domination, souvent travestie en « jeux » teintés de sadisme.
- L’inceste oncle/tante, qui sidère l’enfant, souvent répété au sein des familles et pouvant provoquer une régression (énurésie, mutisme).
- L’inceste grand-parental, nie l’interdit intergénérationnel, parfois difficile à croire par les parents qui n’ont pas vécu l’inceste.
Le rôle du thérapeute : patience, observation et humilité.
Face à ces traumatismes, le thérapeute doit adopter une posture d’écoute humble et respectueuse : observer sans interpréter, poser des questions factuelles (« où ? quand ? comment ? »), permettre au client de représenter sa famille, identifier les rôles inversés.
Lorsque le moment est venu, il peut proposer des phrases réparatrices qui redonnent à chacun sa juste place et rendent la responsabilité à qui de droit. Le processus n’est pas de rompre avec la famille, mais de choisir la vie, libéré du lien malsain, tout en continuant d’appartenir au système familial d’une façon plus juste.
Le travail thérapeutique s’inscrit dans la durée : observation, patience, sécurité, bienveillance. L’amour, parfois exprimé de façon perverse dans ces dynamiques, doit aussi être reconnu, pour permettre à la victime de s’extraire sans nier son histoire.
L’enfant blessé a avant tout besoin de trois choses fondamentales :
- la reconnaissance (être entendu et cru),
- la justice (un cadre qui protège et répare),
- le temps (un chemin de guérison respectueux de son rythme).
En conclusion
Parler de l’inceste et du climat incestuel, c’est lever le voile sur une réalité douloureuse mais nécessaire à regarder en face. Derrière chaque symptôme, chaque silence, il y a un enfant blessé qui a besoin d’être reconnu. La société entière est appelée à évoluer, car protéger les enfants, c’est protéger l’avenir.
Un jour, la victime peut enfin dire :
« Je me répare, je guéris, je laisse le reste. »
Les outils proposés selon le besoin sont l’EMDR, l’hypnose, la Logosynthèse, l’EFT, la thérapie non-duelle.
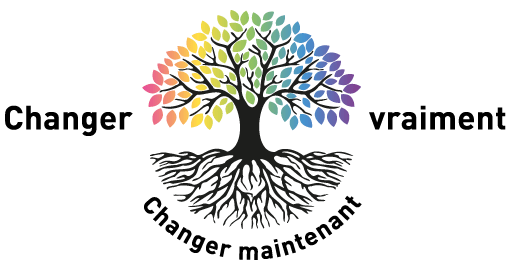
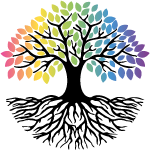
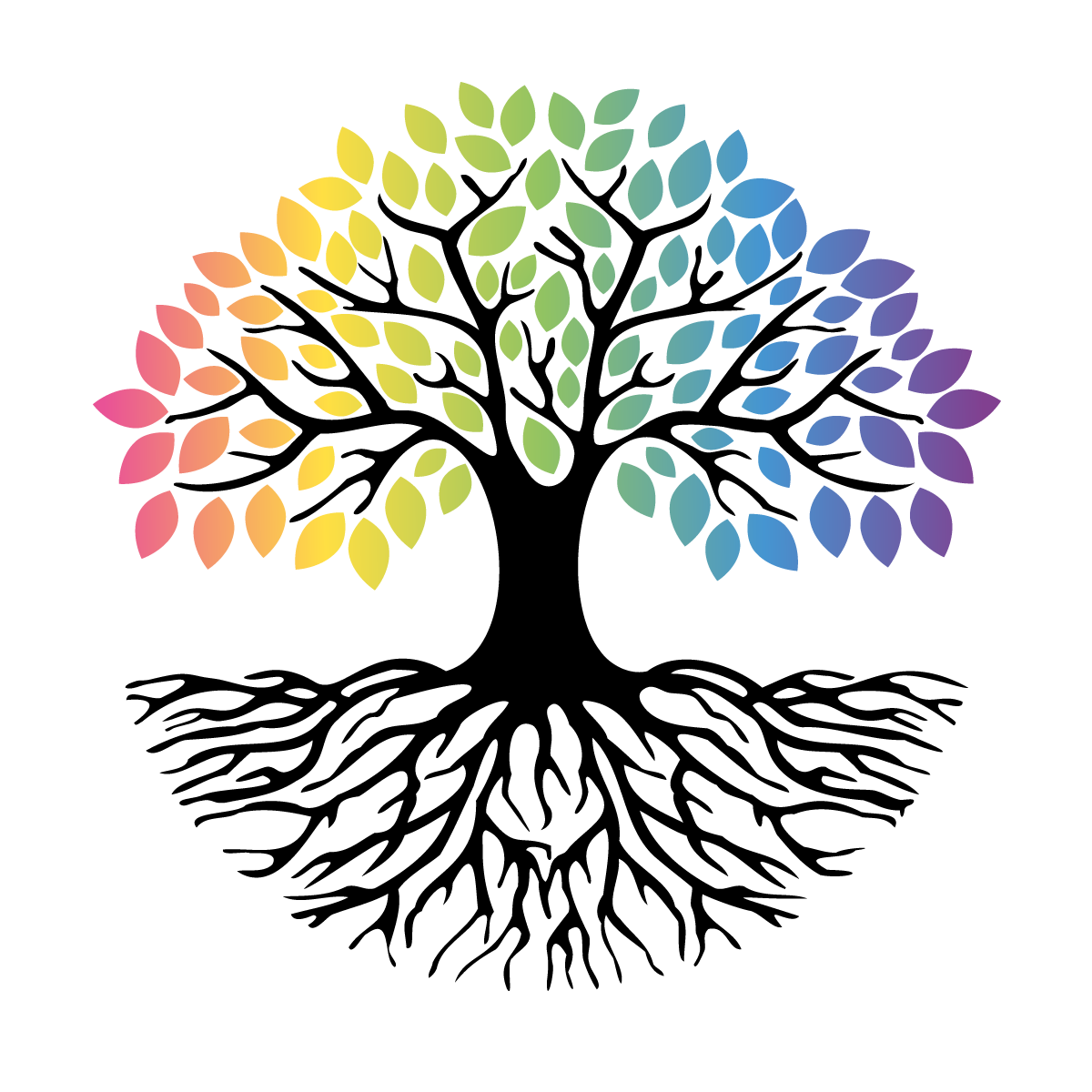




Les Dangers de l’IA en Lien avec les Suicides de Jeunes
Lire la suite